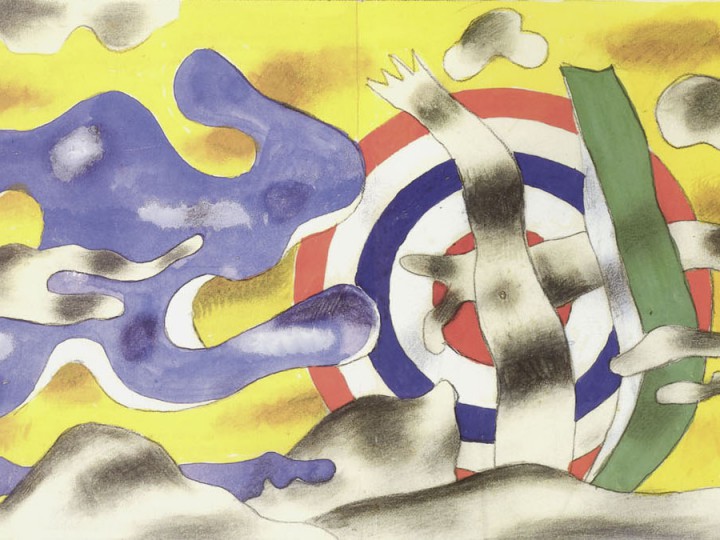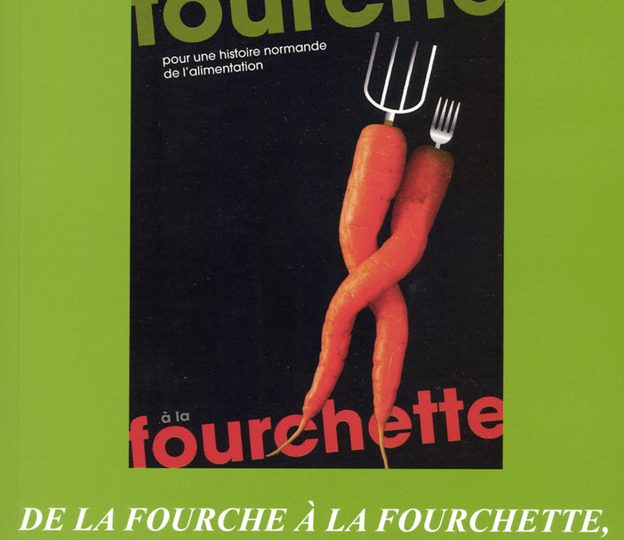Camille Morineau : Oser le nu – Le nu représenté par les artistes femmes (Flammarion, 2025)
Notes de lecture
Miss-Tic : Quand l’amour sort de sa coquille, la beauté tombe des nues (2017)
Titre, sous-titre et illustration de couverture
Les mots de ce titre sont pesés et soupesés. « Oser le nu » semble pourtant en deçà de l’histoire censée révélée par ce livre, lequel confirme amplement que les artistes femmes ont travaillé le nu depuis des siècles avec franchise, clairvoyance et délices. Le « nu transgressé » semblerait plus conforme au contenu de cet essai. Les « artistes femmes » n’ont pas seulement osé le nu, elles l’ont travaillé à bras le corps jusqu’à l’os.
« Représenté » est préféré à « vu » dans le sous-titre. « Représenté » ou Re-présenté ? Ce terme est malicieux en suggérant que les artistes femmes « représentent » discursivement ce que les artistes hommes « présentent » mais il est discutable en laissant entendre que la création féminine n’est pas spontanée mais commentaire de la masculine. Le nu vu par les artistes femmes traduirait également mieux la conviction sans cesse martelée par l’auteure que la grande supercherie du patriarcat est de ne pas avoir « vu » cette fabrique active de nus signés par des femmes.
Cependant, pour éviter la répétition du mot « nu » on peut envisager ce titre et sous-titre : « Le nu transgressé – Le corps figuré par les artistes femmes ». Il va de soi que les artistes ne se confrontent pas à la question du « nu » mais à la figuration et défiguration des corps. Camille Morineau qui a un tropisme pour les images littérales de l’acte sexuel rejette aux oubliettes les allusives, poétiques et néanmoins si radicales évocations de la sexualité. Il nous semble pourtant qu’un bouquet de fleurs tenu par Séraphine de Senlis comme prisonnier du vase ou ses chatoyants « arbres de vie » sont de sidérantes projections psychiques de son ressenti sexuel et au final, des autoportraits d’elle, nue. On le sait bien, la peinture est chose mentale et un nu abstrait ou partiellement dévoilé voit sa charge et sa portée démultipliées.
Choix judicieux, l’illustration de la couverture figure une jeune femme de dos scrutant une boule de cristal dans la photographie visionnaire Dawn d’Alice Bougthon (1909). En ce cas d’espèce, ce nu n’est nullement commentaire second d’une œuvre première masculine mais fulgurance spirituelle et peut-être même spirite de la photographe. Nouvelle Éos sortie de la mer, sœur de Séléné et d’Hélios, cette chiromancienne rêve-t-elle à une aube se levant sur un monde débarrassé de l’infâme machisme ?
Quatre lancinantes questions et cinq contre-exemples
Le projet d’Oser le nu est prometteur. Ce sujet est analysé plus ou moins savamment dans nombre de monographies et d’études transversales. Le panorama dressé par Camille Morineau, à l’origine des indispensables exposition elles@centrepompidou (2009) et de l’association AWARE – Archives of Women Artists, Research and Exhibitions (2014), est moins une histoire du « nu représenté par les artistes femmes » qu’une histoire du « nu représenté par les femmes artistes ». Camille Morineau établit donc, selon la formule consacrée, une histoire au prisme du genre à laquelle je préfère une histoire au prisme des Gender Studies. Au même titre que je sensibilise depuis quarante ans, toutes sortes de publics, à des histoires des arts et non à une histoire de l’art. Les œuvres d’art étant des variations sur l’espace-temps, l’autrice esquisse brillamment une « première cartographie », en vue de faire « émerger un territoire » d’une « nouvelle géographique » (page 20). « Géographique » ou « Géoplastique » ? Chacun tranchera mais ce panorama est riche en découvertes notamment dans le chapitre « Explain Black – Décentrer, dé-genrer, repoétiser le nu noir » quand bien même, il oublie les sensibles portraits de Joséphine Baker par Madame d’Ora (Dora Kallmus, dite).
La page de garde du livre indique un champ temporel d’investigation « du XVIe au XXe siècle », ce qui reste très large et n’autorise qu’un survol des œuvres. Au risque de desservir son ambition, l’autrice préfère la multiplication des noms d’artistes à l’analyse détaillée d’œuvres d’exception, assorties de listes de noms. Elle hésite également mais l’assume entre le récit chronologique et thématique, au risque d’égarer ou de perdre ses lectrices/lecteurs. Certains sous-chapitres déçoivent en leur développement par rapport à leur intitulé accrocheur. Si le « pénis domestiqué » ou pas est l’objet d’une vingtaine d’illustrations dans le livre, le « vagin étendard » apparait dans à peine cinq au point que l’on doute de la justesse de cette formulation. Embrasser un champ historique si étendu réclamait sans doute une équipe dédiée de relecteurs.
La première illustration, en page 6, n’est pas commentée par l’autrice. C’est la très célèbre reproduction de Do women have to be naked to get into the Met. Museum? des GUERILLA GIRLS, CONSCIENCE OF THE ART WORLD (1989). J’explique depuis trente-cinq ans à mes auditeurs de la Grande-Chaumière, par exemple, que, sauf cas d’école, pas une artiste femme n’a éludé, ou plus ou moins travaillé la figuration des corps nus. Camille Morineau ne dit pas autre chose et dès lors, la légitime question posée par les activistes féministes en 1989, résonne autrement. Page 10, la troisième illustration du livre semble également un contre-exemple. C’est la représentation littérale de Fuck Painting #1 de Betty Tompkins (1969) qui ressemble comme une sœur à la toile de la page 213 : Purple Passion (1973) de Joan Semmel, révélée par sa série Fuck Paintings de 1970-1971. Camille Morineau conte l’anecdote selon laquelle elle n’a pas dormi de la nuit avant de proposer l’acquisition de la première de ces œuvres au comité d’acquisition du Centre Pompidou qui l’accepta… comme une lettre à la poste.
Le troisième contre-exemple du livre est capital et il faut rendre hommage à Camille Morineau de l’exposer en toute honnêteté. Il tient notamment à l’article historique de Linda Nochlin : Why Have There Been No Great Women Artists? paru dans ARTnews en janvier 1971. C’est la première des quatre lancinantes questions. Intéressante synthèse, il apparaît aujourd’hui que ce pamphlet contenait nombre de clichés et d’approximations que Camille Morineau s’emploie à renverser. Confrontée à la réalité des collections publiques ou privées, elle admet, page 57, que dès le début du XVIIIe siècle, « les femmes ont eu accès aux modèles nus, masculins et féminins, à partir du moment où elles se trouvaient dans un milieu où cette pratique se justifiait ». Page 75, elle contre deux exemples avancés par Linda Nochlin comme révélateurs des obstacles forgés par le système patriarcal pour entraver les carrières féminines artistiques. La photographie de femmes travaillant, vers 1855, la sculpture d’après une vache, à la Pennsylviana Academy of the Fine Arts, soi-disant faute d’accès à un modèle vivant est un leurre, Thomas Eakins ne s’opposant nullement à ce que les jeunes femmes soient confrontées au modèle vivant. De même, inférer que Marie Bashkirsteff figure un adolescent comme modèle dans L’Atelier de l’Académie Julian (1881) du fait qu’elle n’aurait pas accès à des séances de modèles vivants tant féminins que masculins est faux, son journal prouvant largement le contraire. En définitive, dans son ardeur à attirer l’attention sur les – réelles – mauvaises dispositions des institutions quant aux trajectoires artistiques féminines, Linda Nochlin a retenu pour son article, un titre tôt disqualifié à mes yeux. La seconde question est en filigrane dans le même article : Pourquoi les femmes n’ont-elles pas produit de nus ? Moins encore, de nus d’hommes ? En 2025, Camille Morineau dément ces trois questions désormais obsolètes et pose courageusement la quatrième obsédante question dès le quatrième de couverture de son ouvrage : « N’est-ce pas nous, collectivement, qui n’avons pas su et ne savons toujours pas regarder le nu vu par les femmes » ?
Regarder les œuvres sans grilles de lecture
Page 27, l’enluminure d’Hildegarde de Bingen : L’Homme dans le cosmos (1220-1230) comporte une phallophanie – terme dû à l’excellent Alexandre Leupin[1] – c’est-à-dire la figuration d’un phallus reliant, ici, le bas-ventre au sternum. Au demeurant, cette phallophanie a inspiré Ithell Colqhoun métamorphosant en 1938 pour Scylla (page 165) deux cuisses féminines en vits géants. Page 31 et 33, la détrempe sur bois de Plautilla Nelli : Lamentation avec saints (vers 1550) et l’huile sur toile de Sofonisba Anguissola : Pietà (1574-1585) comprennent aussi des phallophanies, qui n’auraient pas échappé à Leo Steinberg ou André Chastel[2].
Page 29, placer la Naissance de Vénus (1484-1486) de Sandro Botticelli au « nombre des stéréotypes de nus féminins signés par des hommes » est navrant. Ode saphique inattendue, la Naissance de Vénus et le Printemps sont un diptyque d’un palais des Médicis. Dans la Naissance de Vénus, celle-ci aborde l’île de Lesbos, les pieds en bordure du repli d’une coquille Saint-Jacques, métaphore sexuelle explicite à qui prend le temps de regarder la forme de ce repli ou « Venusberg ». Dans le Printemps (1477-1478) Vénus bénit une scène d’allégresse saphique dans le jardin des Hespérides. Les Trois Grâces et Flore s’y ébrouent librement, les deux hommes, Mercure et Zéphyr, tenus à l’écart de toute réjouissance.
Ce n’est rien ôter au talent d’Artemisia Gentileschi que de contester, page 51, l’appréciation estimant qu’il n’y a « rien de maniéré » dans sa Danaé (1612). L’artiste a développé autant que faire se peut, le corps de son modèle dans l’espace pour en révéler le maximum de beauté(e) dont sa chevelure couleur d’ambre ou un sein ramené dans le plan de la toile en une manière pré-ingresque. Prenons le temps d’observer qu’il n’aura pas été de tout repos pour le modèle de tenir longtemps cette pose artificielle feignant la détente du sommeil lorsque le bas-ventre accuse une fluide inspiration d’air.
L’historienne d’art décrit les dessins à la sanguine et les tableaux de Berthe Morisot figurant Gabrielle Dufour, sa jeune voisine de Mézy-sur-Oise (1891), habillée et nue. Cette gardienne de chèvre adolescente n’est pas une « jeune adulte » (page 72) et la malice de l’artiste tient surtout au clin d’œil au conte tragique d’Alphonse Daudet : La chèvre de Monsieur Seguin (1866), si empressée d’aller découvrir le monde. Au demeurant, Berthe Morisot n’est pas la seule artiste femme ayant figuré des adolescent(e)s nu(e)s. Si Camille Morineau cite celles-ceux dessiné(e)s ou peint(e)s par Suzanne Valadon, elle n’évoque pas ceux/celles de Louise Breslau, de Mariette Lydis ou de Doris Doc Procter. Pourtant, le Fonds Marc Vaux du Centre Pompidou comprend des clichés de fillettes nues réalisés pour le Salon de l’Union des Femmes Peintre et Sculpteurs de 1948. Page 116, Camille Morineau estime que le « Sauna » de Zinaïda Serebriakova (ou plutôt, le Bain) « remet à sa place » le Bain Turc d’Ingres sacrifiant à « l’exotisme » et miné par un « regard masculin » mais elle passe sous silence l’audacieux portrait nu d’Ekaterina Serebriakova par sa mère.
Le tableau de Paula Modersohn-Becker : Autoportrait au sixième anniversaire de mariage, reproduit page 17, est crédité réalisé « en 1906 ». Nous lisons page 94 la doxa habituelle sur cette œuvre : « elle se peint enceinte alors que l’œuvre date d’avant sa grossesse ». Tout dans la pose de Paula Modersohn-Becker et son regard inquiet vers le miroir hors-champ, indispensable à l’autoportrait, contredit cette interprétation. Il est établi que Paula Becker s’est mariée le 25 mai 1901 et « fête » son sixième anniversaire, le 25 mai 1907, date à laquelle elle est enceinte puisqu’elle disparaîtra tragiquement, des suites de l’accouchement, le 20 novembre 1907. Par ailleurs, page 95, son Nu féminin allongé de 1905-1906 est-il vraiment exempt de tout « référent symbolique » ? C’est faire litière du motif ornant la tapisserie, version gothique d’une vulve.
Page 107-108, l’auteure commente la Joie de vivre de Suzanne Valadon (1911) : « Un homme nu regarde timidement, de l’autre côté d’un ruisseau, quatre femmes, dont une noire […] absorbées dans les gestes quotidiens de leur toilette ». Hélas, il n’y a pas de ruisseau dans la toile, la « noire » est moins africaine que métisse et l’une des femmes s’étire voluptueusement au point de fourrager de ses doigts la chevelure de sa voisine.
Camille Morineau estime de la Vénus noire de Suzanne Valadon (1919) qu’elle est « debout mais sans poser » (page 108). C’est méjuger ce portrait ou plutôt cet explosif autoportrait en pied. Cette Vénus noire a le visage de Suzanne Valadon, et les branches des arbres de part et d’autre dessinent un grand « S » et un grand « V ». Non seulement, Suzanne Valadon pose – poser n’est pas synonyme d’afféterie – dans le plus simple appareil mais elle quête le regard de la spectatrice/du spectateur. Ce faisant, la révolutionnaire peintresse pulvérise tout préjugé racial. Contre toute attente, page 107, Camille Morineau ne rebondit pas sur le témoignage qu’elle cite de l’altière Suzanne si éloquent quant à la confusion des genres : pour Puvis de Chavannes, j’ai « posé non seulement les femmes, mais les jeunes gas [sic] ».
Page 113, grande est notre surprise de voir le très ambitieux tableau de Mela Muter affublé du titre racoleur : Nu cubiste jambes écartées (1919-1923) ! Quel artiste homme ou femme de l’époque à jamais intitulé ainsi une de ses œuvres ? Pourquoi ce tableau aurait-il changé de nom depuis sa vente chez DESAunicum le 4 juin 2020 ou depuis l’exposition Pionnières (2022) qui le nommait simplement : Nu cubiste comme partout ailleurs ? C’est faire injure à Mela Muter et dévaloriser son entrée en force dans l’épopée cubiste tout comme son exploit d’allier une allure totalement féminine à une musculature d’haltérophile.
En dépit de la ferveur de notre époque pour l’uchronie, l’histoire avec un grand H est intraitable et Marie Vassilieff ne fait pas partie des artistes défendu(e)s par la méritante « Berthe Weil » (page 109). Marie Vassilieff se définit dans ses mémoires : Bohème du XXe siècle comme « ni homme ni femme »[3]. Elle a aussi bien surmonté le corps de sa Poupée autoportrait nue (1920-1929), reproduite page 114[4], de son masque autoportrait que de celui du peintre hongrois István Farkas. C’est assez dire qu’elle se soucie peu des notions de cisgenre et transgenre. Elle ne relève pas d’un cubisme « genré » pas plus qu’elle « n’explore des figures androgynes » mais travaille au-delà des genres et des scolaires oppositions binaires.
De notre point de vue, le travail insolite et si révélateur de Marie Vassilieff sur le masque, les poupées-portraits ou les marionnettes dépasse très largement une simple réaction au travail de Pablo Picasso sur le « masque/visage » (page 114). Obnubilée par la démonstration que les artistes femmes ont fait mieux ou plus tôt que les artistes hommes, Camille Morineau, nous l’avons vu, conçoit essentiellement les œuvres féminines comme des réactions, des commentaires ou des réponses à des œuvres masculines. Hélas, ce tac-tac férocement binaire éclipse la force intrinsèque des propositions féminines. Celles-ci sont, certes, en partie des répliques ironiques ou sarcastiques à des créations masculines comme il en va des dialogues entre confrères masculins et elles sont plus largement encore motivées par l’état de violence engendré par le patriarcat mais elles sont in-fine et toutes en finesse, expressions de tempéraments fougueux. Fatalement, l’histoire de l’art suggère des comparaisons mais après avoir défini la singularité d’une œuvre et non l’inverse comme le fait Camille Morineau.
Si Nue (1913) et « Scipion le Noir » (1915) – dit aujourd’hui Scipion, l’Africain – furent présentés en regard au Musée Pouchkine (2021) grâce à la bienveillance de Sylvie Buisson pour l’artiste puis à la Galerie Françoise Livinec (2022), rien ne prouve qu’il s’agisse d’un « diptyque » (page 114). Supposer que Nue est une « alternative au cubisme et au réalisme » – vaste fourchette temporelle – et Scipion, l’Africain une « interprétation dégenrée de l’Olympia de Manet » témoigne, une nouvelle fois, de ce travers de comparer avant de tenter de saisir ce que Marie Vassilieff cherche et recherche et les moyens plastiques qu’elle déploie pour l’élaboration de son grand œuvre. En l’occurrence, dans Nue, une construction spatiale en rotor, des jeux multiples de trompe l’œil et une mise en abyme, en vue de figurer un nu réfléchissant sur sa lecture au-devant d’un tableau représentant une citrouille. Autrement dit, un tableau programmatique riche de sens et plus encore d’allusions et d’illusions. Pour sa part, Scipion l’Africain qui présente un Africain en majesté, constitue un fameux « statement » en 1915, si l’on considère que cette odalisque à l’obélisque procède de dizaines de dessins figurant des Africains ou Africaines arborant notamment librement lances et boucliers.
En 1910, Marie Vassilieff n’a pas « exposé régulièrement au Salon des Indépendants » (page 115) puisqu’elle y participe pour la première fois en 1910. Marie Vassilieff n’a pas « transformé son atelier en cantine » « après la guerre » (toujours page 115) mais pendant la guerre pour subvenir notamment aux artistes impécunieux. Si elle a bien co-organisé le célèbre banquet offert à Georges et Marcelle Braque dans cette cantine, le dimanche 14 janvier 1917, Georges Braque, longtemps mobilisé, n’a pu en être la figure de proue. De même selon les mémoires de Marie Vassilieff, au titre des musiciens, Erik Satie fut moins présent au piano de la cantine que le Suédois Henrik Melcher Svensson ou l’Espagnol Ricardo Viñes. Je m’attarde sur le mauvais traitement réservé à Marie Vassilieff parce que le siège d’AWARE occupe son ancien atelier-cantine, Villa Marie-Vassilieff (Paris 15e), et que ses visiteurs ont droit à des renseignements fiables.
En définitive, l’interdisciplinarité artistique de Marie Vassilieff fut au service des combats intersectionnels féministes. C’est pourquoi, si son travail au-delà des genres est bien acté par Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici[5], il ne doit pas occulter sa défense pionnière du droit des Africains à être représentés en toute noblesse et le sport de combat que fut pour elle, d’aider, via sa généreuse cantine, les artistes indépendants internationaux à ne pas mourir de faim ou de neurasthénie en leur offrant des soirées festives[6]. Que son travail plastique soit parsemé de vierges et de christs « noirs » et d’êtres de genre indéfini est une bénédiction pour l’humanité !
Prétendre page 158 que Tamara de Lempicka « sort l’amour lesbien » des cadres historiques auxquels le cantonnent les hommes revient à ignorer les belles alanguies de la plage de Deauville que figure, dès 1919, Kees van Dongen dans Quiétude. C’est méconnaître les amours de Suzy Solidor et Yvonne de Bremond d’Ars décrits par Foujita, j’en passe et des meilleures. Il est vrai que le catalogue de l’exposition Pionnières laissait croire, bien à tort, que les artistes masculins n’ont pas acté la révolution saphique des Roaring Twenties. Aussi, puisque Camille Morineau évoque successivement Germaine Krull (page 158) et Claude Cahun (page 162), rappelons que Pierre Mac Orlan signe le premier livre sur Germain Krull (1931), la préface des Aveux non avenus de Claude Cahun (1930) et celle des Criminelles de Mariette Lydis (1927).
Au sujet d’Alice Neel, nulle mention de ses femmes enceintes, page 217, chères à Paula J. Birnbaum tout comme sont négligées dans Oser le nu, les femmes allaitant dont celles de Maria Blanchard. Enfin, l’aperçu sur l’œuvre immense d’Ana Mendieta est vraiment trop court, page 188. Assurément, Rape Scène (1973) est historique quant à la dénonciation des violences faites aux femmes mais la vigoureuse critique menée par Ana Mendieta du pernicieux rideau de verre opposé aux promotions sociales féminines méritait d’être mentionnée.
Flou artistique, bibliographie étoffée et trous dans la raquette
Selon Camille Morineau, le mot « queer » « apparaît dans la bouche de Gertrude Stein en 1925 » (page 150). Plus concrètement, à l’impossible nul n’est tenu, et il impossible de dater l’apparition de ce mot dans sa bouche. Pour faire court, « Queer » apparaît plusieurs fois dans The Making of Americans: Being a History of a Family’s Progress, édité en 1925, mais dont la page de garde de la première édition indique qu’il fut rédigé de 1906 à 1908 ! « Queer » est utilisé comme un gimmick dans ce roman à clés et rapproché parfois d’un homme « excentrique ». Puis, par exemple, Antoine Mayo livre à Paris-Montparnasse en 1929, un dessin montrant, Percy, le « queer boy of Montparnasse », s’en prenant aux « détrousseurs de vierges ». Il conviendrait notamment, de confronter la bonne fortune de ce mot à celle de « camp » opposé à « kitsch ». Pour conclure, trop vite, sur le flou artistique dont nimbe Camille Morineau le mot « queer », ajoutons que si Germaine Dulac, peut être qualifiée de « créatrice queer » (page 162), elle n’est pas « la première réalisatrice féministe » eu égard à Alice Guy…
Le catalogue de l’exposition Pionnières ne comprenait pas de bibliographie et ses rédactrices citaient essentiellement, en notes, des études parues dans la décennie précédente. Sujet oblige, Oser le nu comporte, cette fois, une bibliographie. La compléter n’entre pas dans le cadre de ces notes de lecture déjà trop longues. Contentons-nous de préciser que si l’étude pionnière de Marie-Jo Bonnet : Les deux amies – Essai sur le couple de femmes dans l’art, (Éditions Blanche, 2000) est citée, le livre Les femmes dans l’art de la même auteure (Éditions de La Martinière, 2004) ne l’est pas.
Ne nous attardons sur les oubliées de cet inventaire ne visant pas à l’exhaustivité : Sonia Delaunay, Noémie Debienne, Mariette Lydis, Hélène Perdriat, Paula Rego ou Apolonia Sokol. L’impasse sur les lys et arums, métaphores de vibrantes vulves, signés par Tamara de Lempicka ou par Georgia O’Keeffe en peinture et par Imoghen Cuningham ou Laure Albin-Guillot en photographie est plus regrettable. Quel homme est parvenu à traduire comme Georgia O’Keeffe dans Jack-in-the-Pulpit (1930) le transport physique interne de l’échange sexuel, à tout le moins hétérosexuel ? Qui a mieux décrit l’explosion du sperme dans les trompes de fallope que Frida Kahlo dans Fleur de la vie (1943) ?
Camille Morineau cite page 197, une diatribe, malheureusement on ne peut plus justifiée d’ORLAN fustigeant l’impardonnable machisme. Aussi laissons à cette artiste d’exception, le mot de la fin. Le jeudi 16 septembre 2021, ORLAN a déclaré, quelque peu dépitée, à l’Espace Belle Rive d’Ouistreham (Calvados) dirigée par la chorégraphe Karine Saporta : – « J’ai l’impression que ma vie n’a servi à rien car on est en train de reculotter la chapelle sixtine »…
Benoît NOËL, chercheur indépendant
[1] Voir Alexandre Leupin : Phallophanies – La chair et le sacré, Paris, Éditions du Regard, 2000.
[2] Leo Steinberg – Préface d’André Chastel – Traduction de Jean-Louis Houdebine : La sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, Paris, L’Infini Gallimard, 1987.
[3] Archives de Claude Bernès, feuillet 2.
[4] Photographie de Pierre Delbo, Archives de Claude Bernès.
[5] Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici : Femmes Artistes – Artistes Femmes : Paris de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007. « Bien loin de proposer un autoportrait, une mascarade ou un travestissement, voire quelque question sur l’identité sexuelle, ces corps sont anonymes et abstraits », p. 115.
[6] Anonymous, “Bohemians Xmas in Quartier Latin”, The International Herald Tribune, 26 December 1914, page 2.
Categories:Articles divers, Uncategorized
0 Likes